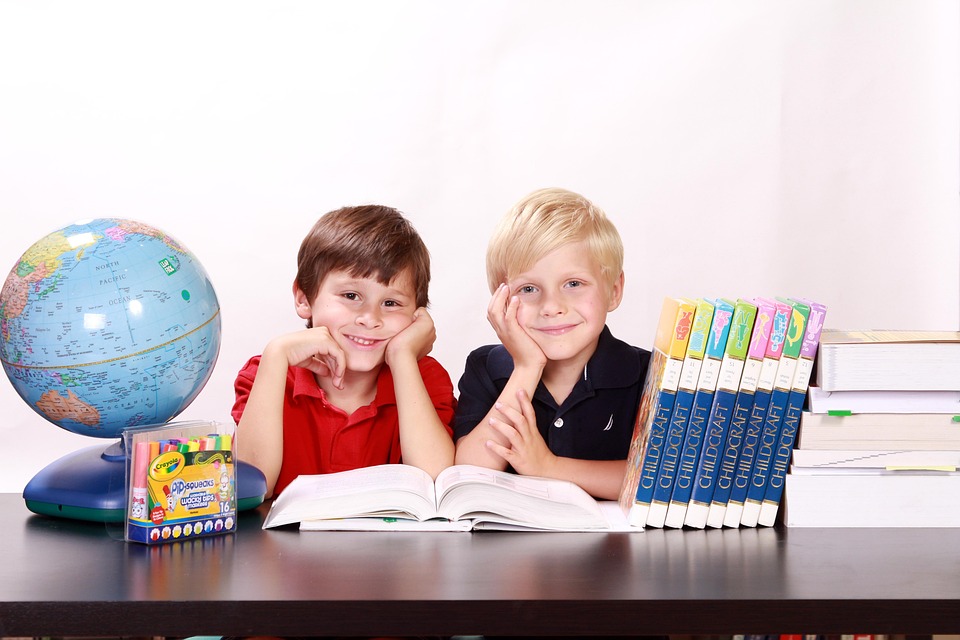Biais cognitifs : comprendre comment notre cerveau peut se tromper (et mieux vérifier l’information)
Niveau et public cible
Collège – Élèves (5e à 3e)
Objectifs pédagogiques
- Comprendre ce qu’est un biais cognitif et son impact sur nos jugements en ligne.
- Identifier des biais fréquents (confirmation, disponibilité, halo, ancrage) dans des exemples concrets.
- Être capable d’appliquer une méthode simple de vérification de l’information avant de partager.
- Développer une posture réflexive et citoyenne face aux contenus numériques.
Contenus détaillés
Un biais cognitif est une manière rapide mais imparfaite pour notre cerveau de traiter l’information. Il nous aide à aller vite, mais peut nous induire en erreur, surtout sur les réseaux sociaux où les messages sont courts et émotionnels.
Biais de confirmation : nous cherchons et retenons surtout ce qui confirme ce que nous pensons déjà. Exemple : taper “les devoirs sont inutiles preuves” au lieu de “effets des devoirs au collège études”.
Biais de disponibilité : nous surévaluons ce qui vient facilement à l’esprit parce que c’est récent, marquant ou vu souvent. Exemple : croire qu’un danger est très fréquent car on a vu plusieurs vidéos virales à ce sujet.
Effet de halo : une caractéristique positive (ou négative) d’une personne ou d’une marque colore notre jugement sur tout le reste. Exemple : penser qu’un influenceur “sympa” a forcément raison sur un sujet scientifique.
Biais d’ancrage : la première information rencontrée sert de repère et influence la suite. Exemple : un premier chiffre (même imprécis) oriente notre estimation.
Mini-méthode de vérification (en 4 étapes) :
1) Stop : faire une pause avant de partager.
2) Source : identifier qui publie (compte original, média, auteur, intérêts).
3) Recouper : chercher au moins 2 sources fiables indépendantes et datées.
4) Origine : remonter au contenu initial (image/vidéo/étude) pour vérifier le contexte.
Astuce pratique : reformuler une recherche de manière neutre (“effets de…”, “études sur…”, “comparaison…”) et ajouter “site:edu”, “site:gouv” ou “méta-analyse” peut aider à limiter le biais de confirmation.
Activités pratiques
- Exercice 1 : Tri d’indices de fiabilité (20 min)
Matériel : 8 petites cartes “indices” à imprimer (exemples : auteur identifiable, date précise, titre sensationnaliste, source unique, lien vers étude, image recadrée, orthographe soignée, conflit d’intérêts).
Consigne : Par groupes, classer chaque carte en “rassurant”, “à vérifier”, “inquiétant”. Justifier en une phrase. Mise en commun rapide. - Exercice 2 : Biais de confirmation en action (25 min)
Par binômes, chaque élève choisit une affirmation d’actualité neutre (ex. “Les siestes améliorent l’attention en classe”). Recherche A : requête orientée qui confirme. Recherche B : requête neutre/contraire. Comparer les résultats (types de sources, dates, vocabulaire). Conclure : qu’est-ce qui change ? - Jeu ou débat : Procès de la rumeur (30 min)
Rôles : “accusation” (défend la rumeur), “défense” (la critique), “experts” (vérifient source, date, origine), “jury” (décide si la rumeur est fiable). Chaque équipe doit citer au moins 2 indices et 2 sources. Debrief : quels biais ont été repérés ?
Quiz interactif EMI
Réponds puis clique pour vérifier :
Fiche synthétique
- Les biais cognitifs sont des raccourcis mentaux utiles mais sources d’erreurs (confirmation, disponibilité, halo, ancrage).
- Avant de partager : Stop, vérifier la Source, Recouper, remonter à l’Origine du contenu.
- Formuler des recherches neutres et comparer des sources indépendantes aide à limiter les biais.
Catégorie du site recommandée
Mon cours du jour / Je m’entraîne avec un quiz